Obliger la mise de côté de REER pour les particuliers
Re: Obliger la mise de côté de REER pour les particuliers
Je vais vous dire honnêtement que c'est la première fois de ma vie que j'ai peur de vieillir 
C'est drôle que tu me dises que j'ai mauvais caractère parce que si tu parles à ceux qui me traitent avec respect et courtoisie et qui ne me mentent pas et qui ne tentent pas de me f******, ils vont probablement te dire qu'au contraire je suis très gentil- Jean-François Mercier
Re: Obliger la mise de côté de REER pour les particuliers
Moi j'ai surtout peur de me faire voler par le gouvernement. Ils sont bien bons pour s'approprier l'argent des programmes, juste à voir comment ils ont pigé et continue de piger dans la caisse de l'assurance-chômage.  L'affaire c'est qu'on nous enlève déjà des sous pour nos vieux jours avec le RRQ, qu'ils nous mettent ca dans un REER alors si c'est si une bonne idée.
L'affaire c'est qu'on nous enlève déjà des sous pour nos vieux jours avec le RRQ, qu'ils nous mettent ca dans un REER alors si c'est si une bonne idée.
Qu'on se le dise : Chacun sa connerie!! - Claude Dubois 
Re: Obliger la mise de côté de REER pour les particuliers
Ainsi, certaines personnes (dont l ’ex-ministre Claude Castongay) croient que le gouvernement devrait obliger les citoyens à mettre de l’argent de côté pour leurs vieux jours, car la majorité des gens ne sont pas assez intelligents pour le faire par eux-mêmes
Dans le fond, ce qu'il dit Martineau, c'est qu'il reproche au gouvernement de penser que les gens sont pas assez intelligents pour le faire par eux-mêmes, alors le Gouvernement décide d'obliger les citoyens à contribuer aux Reer.
Et il dit aussi: tant qu'à vouloir gérer les citoyens, gérons les jusqu'au bout!.
Dans le fond, ce qu'il dit Martineau, c'est qu'il reproche au gouvernement de penser que les gens sont pas assez intelligents pour le faire par eux-mêmes, alors le Gouvernement décide d'obliger les citoyens à contribuer aux Reer.
Et il dit aussi: tant qu'à vouloir gérer les citoyens, gérons les jusqu'au bout!.
Dernière modification par Soleil47 le dim. janv. 16, 2011 1:43 pm, modifié 1 fois.
Re: Obliger la mise de côté de REER pour les particuliers
On a tous un peu peur de vieillir, plus on avance en âge et plus on se pose la question: va t'on vivre une belle vieillesse en santé ou bien la vivra t'on malade et que nous n'aurons plus aucune qualité de vie???pucinette a écrit : Je vais vous dire honnêtement que c'est la première fois de ma vie que j'ai peur de vieillir
Re: Obliger la mise de côté de REER pour les particuliers
Soleil47 a écrit : [...]
On a tous un peu peur de vieillir, plus on avance en âge et plus on se pose la question: va t'on vivre une belle vieillesse en santé ou bien la vivra t'on malade et que nous n'aurons plus aucune qualité de vie???
Moi je me pose plus de questions sur ma santé financière que ma santé physique
C'est drôle que tu me dises que j'ai mauvais caractère parce que si tu parles à ceux qui me traitent avec respect et courtoisie et qui ne me mentent pas et qui ne tentent pas de me f******, ils vont probablement te dire qu'au contraire je suis très gentil- Jean-François Mercier
Re: Obliger la mise de côté de REER pour les particuliers
mon chum a fait une faillite personnelle de 20 milles et personnes n'a pris ses reersploloto a écrit : Quelques réflexions.
Tu fais une faillite personnelle, ils t'ont obligé à cotiser des reer pendant des années. Le gouvernement va les saisir pour se payer.
Dans ta famille, ils sont tous morts à 40 ans d'une crise cardiaque, voulez-vous bien me dire l'utilité pour cette personne de mettre dans des reer.
Regardez la page de décès et voyez l'âge des décédés. Beaucoup, sinon une bonne gang meurent avant l'âge de la retraite.
Tu as mis dans tes reer pendant 25 ans, l'usine ferme, tu as du chomage, ensuite du BS. Mais avant tu dois bruler tes reer. Ca va être laid quand tu vas vouloir avoir du BS. C'est déjà laid quand tu as été travailleur autonome car ils exigent tes rapports d'impôt et des rapports financiers complets pour justifier ta demande.
"La vie serait bien plus heureuse si nous naissions à 80 ans et nous approchions graduellement de nos 18 ans"
Mark Twain


Mark Twain


Re: Obliger la mise de côté de REER pour les particuliers
Publié le 15 janvier 2011
Facile, la faillite?
Louise Leduc
La Presse
La perspective de faire faillite est source d'angoisse. N'empêche, quand il faut s'y résoudre, il arrive que les conséquences et l'opprobre social soient moins pénibles que ce que l'on avait redouté. Car si l'on peut s'endetter très vite, on peut aussi, après une faillite, écourter de beaucoup les sept années officielles de purgatoire, d'autant plus que les banques ont très hâte de récupérer leurs clients.
Aller chez le syndic et lui «confesser» des dettes de 60 000$ a été «l'humiliation suprême» pour Myriam, qui constate que c'est loin d'être le cas pour tout le monde. «Depuis que ça m'est arrivé, je m'étonne de voir autour de moi quantité de personnes s'endetter sans s'en faire, en disant très ouvertement que, au pis-aller, ils feront faillite.»
Jacques Nantel, professeur à HEC-Montréal, est encore ébahi par cette déclaration d'une jeune femme qui lui a dit récemment qu'elle s'apprêtait à partir pour plusieurs mois en Grèce, à crédit, et qu'au retour, elle ferait tout simplement faillite si elle n'arrivait pas à payer tout cela.
Dans une étude sur l'endettement publiée en octobre, la Banque Toronto Dominion le constate: «La stigmatisation sociale associée à la faillite a diminué. Dans les années 50 ou 60, ceux à qui cela arrivait avaient du mal à le dire ouvertement. De nos jours, ceux qui se retrouvent dans cette situation reçoivent support et compréhension. Plus encore, dans le marché du crédit, ils ne sont plus considérés comme des parias.»
Myriam l'a vécu. Une fois passé le sentiment initial de déshonneur lorsqu'elle a déposé son bilan, tout n'a été que soulagement: «Tu as 60 000$ de dettes, tu as cette boule dans le ventre qui ne te quitte pas. Puis tu vas chez le syndic et, quand tu en ressors, tes dettes sont rayées.»
Contre toute attente, Myriam n'a pas eu à rendre sa voiture, les concessionnaires ayant peu d'appétit pour la reprise de véhicules. Les sofas de cuir n'ont pas été saisis non plus. Quand vous faites faillite, on vous laisse toujours pour 6000$ de meubles, et davantage encore dans les faits puisque les créanciers considèrent aussi les meubles saisis comme sans intérêt. Les REER n'y passent pas non plus, sauf pour ce qui est des cotisations faites au cours des 12 mois qui précèdent la faillite.
«Et c'est sans compter sur tous ces voyages que j'ai faits à crédit. Mes souvenirs, on ne pouvait pas me les reprendre non plus», fait observer Myriam.
Samuel tient le même discours: «J'avais un peu honte de ne pas payer mes dettes. J'ai été surpris par l'accueil chaleureux du syndic. On m'a tout de suite déculpabilisé en me disant que ce n'était pas ma faute, que c'étaient les banques qui m'avaient incité à m'endetter.»
«Je suis très reconnaissant envers mon syndic. J'ai pu reprendre mes finances en main et retrouver ma tranquillité d'esprit», dit-il.
Bien sûr, la cote de crédit écope pour un temps, mais il est faux de penser qu'il faut sept ans après une faillite pour se refaire un crédit. Dans la réalité, après trois ans, il est possible d'emprunter de nouveau si l'on a un emploi et des revenus stables, si l'on n'a pas changé d'adresse pendant ces années-là et que l'on s'est assuré de ne faire aucun chèque sans provision.
«De fait, si on fait faillite à 30 ans et qu'à 32 ans, on trouve un bon emploi, on peut facilement se procurer une nouvelle carte de crédit. Il suffit d'éviter d'aller à la banque à qui on devait de l'argent», relève Clémence Gagnon, conseillère budgétaire à l'ACEF de Québec.
Les magasins sont particulièrement prompts à donner des cartes au premier venu, note Marie Lachance, professeure en sciences de la consommation à l'Université Laval. «Ils offrent 10% de rabais sur l'achat du jour ou un petit stylo, et beaucoup de gens prennent la carte de crédit seulement pour le cadeau.»
Pénalisée?
Maintenant au fait de tout cela, Gisèle, elle, est la première à regretter d'en avoir fait une question d'honneur et de ne pas avoir déposé son bilan. En lieu et place, elle a fait une proposition à ses créanciers, qui ont été payés à 92%, raconte-t-elle. Elle en a pour cinq ans à les rembourser. Ensuite commenceront les années au cours desquelles elle aura à se rebâtir un crédit, tout comme quelqu'un qui a fait faillite. Bref, ça n'en finit plus. «J'ai été très mal conseillée. Mon conseil à ceux qui se seraient retrouvés dans ma situation, c'est le suivant: si vous avez de grosses dettes et n'avez aucun actif à protéger, déclarez faillite. Si je l'avais fait, j'aurais recommencé à zéro, et au lieu de peiner à rembourser mes dettes, j'aurais mis de l'argent de côté.»
(Fait à noter, cependant: une personne qui a fait faillite peut être tenue, dans les neuf mois suivants, de verser une partie de ses revenus mensuels nets s'ils excèdent la limite déterminée par les normes du Bureau du surintendant des faillites. Pour un célibataire, le coût de la vie est évalué à 1884$ par mois. S'il gagne 2184$, il devra rembourser 50% des 300$ excédentaires, donc 150$ par mois.)
«Le but de la Loi sur la faillite, dit le syndic Martin Poirier, c'est de faire en sorte qu'un individu redevienne productif pour la société. Personne ne se glorifie de faire faillite, mais il y a des gens que ça affecte moralement plus que d'autres.»
Il trouve lui aussi regrettable que les personnes qui décident, au lieu de déclarer faillite, de faire une proposition à leurs créanciers, au prix de sacrifices autrement plus importants, se retrouvent avec un dossier presque aussi entaché.
Cela dit, même si l'on peut se refaire un crédit en trois ans après une faillite, «c'est long, quand on est habitué d'avoir une carte de crédit, note Marie Lachance, de l'Université Laval. Et ça repousse d'autant la réalisation de rêves, comme de fonder une famille ou acheter un appartement».
***
La faillite en chiffres??
10 000 En 2015, entre 5000 et 10 000 ménages québécois de plus pourraient être forcés de déposer leur bilan. Hélène Bégin, économiste principale chez Desjardins
22,5% Le pourcentage de faillites déclarées au Canada dans la période de 12 mois prenant fin en octobre était de 22,5% plus élevé qu'à la période précédant la récession.
20,6% La proportion de consommateurs insolvables chez les 55 ans et plus a plus que quadruplé au cours des 10 dernières années, passant de 4,6% à 20,6%.
38% Pourcentage de la population active qui n'aurait aucune épargne en vue à la retraite, selon une étude de la Régie des rentes du Québec. Source: Surintendant des faillites.
Source: Sur intendant des faillites
Facile, la faillite?
Louise Leduc
La Presse
La perspective de faire faillite est source d'angoisse. N'empêche, quand il faut s'y résoudre, il arrive que les conséquences et l'opprobre social soient moins pénibles que ce que l'on avait redouté. Car si l'on peut s'endetter très vite, on peut aussi, après une faillite, écourter de beaucoup les sept années officielles de purgatoire, d'autant plus que les banques ont très hâte de récupérer leurs clients.
Aller chez le syndic et lui «confesser» des dettes de 60 000$ a été «l'humiliation suprême» pour Myriam, qui constate que c'est loin d'être le cas pour tout le monde. «Depuis que ça m'est arrivé, je m'étonne de voir autour de moi quantité de personnes s'endetter sans s'en faire, en disant très ouvertement que, au pis-aller, ils feront faillite.»
Jacques Nantel, professeur à HEC-Montréal, est encore ébahi par cette déclaration d'une jeune femme qui lui a dit récemment qu'elle s'apprêtait à partir pour plusieurs mois en Grèce, à crédit, et qu'au retour, elle ferait tout simplement faillite si elle n'arrivait pas à payer tout cela.
Dans une étude sur l'endettement publiée en octobre, la Banque Toronto Dominion le constate: «La stigmatisation sociale associée à la faillite a diminué. Dans les années 50 ou 60, ceux à qui cela arrivait avaient du mal à le dire ouvertement. De nos jours, ceux qui se retrouvent dans cette situation reçoivent support et compréhension. Plus encore, dans le marché du crédit, ils ne sont plus considérés comme des parias.»
Myriam l'a vécu. Une fois passé le sentiment initial de déshonneur lorsqu'elle a déposé son bilan, tout n'a été que soulagement: «Tu as 60 000$ de dettes, tu as cette boule dans le ventre qui ne te quitte pas. Puis tu vas chez le syndic et, quand tu en ressors, tes dettes sont rayées.»
Contre toute attente, Myriam n'a pas eu à rendre sa voiture, les concessionnaires ayant peu d'appétit pour la reprise de véhicules. Les sofas de cuir n'ont pas été saisis non plus. Quand vous faites faillite, on vous laisse toujours pour 6000$ de meubles, et davantage encore dans les faits puisque les créanciers considèrent aussi les meubles saisis comme sans intérêt. Les REER n'y passent pas non plus, sauf pour ce qui est des cotisations faites au cours des 12 mois qui précèdent la faillite.
«Et c'est sans compter sur tous ces voyages que j'ai faits à crédit. Mes souvenirs, on ne pouvait pas me les reprendre non plus», fait observer Myriam.
Samuel tient le même discours: «J'avais un peu honte de ne pas payer mes dettes. J'ai été surpris par l'accueil chaleureux du syndic. On m'a tout de suite déculpabilisé en me disant que ce n'était pas ma faute, que c'étaient les banques qui m'avaient incité à m'endetter.»
«Je suis très reconnaissant envers mon syndic. J'ai pu reprendre mes finances en main et retrouver ma tranquillité d'esprit», dit-il.
Bien sûr, la cote de crédit écope pour un temps, mais il est faux de penser qu'il faut sept ans après une faillite pour se refaire un crédit. Dans la réalité, après trois ans, il est possible d'emprunter de nouveau si l'on a un emploi et des revenus stables, si l'on n'a pas changé d'adresse pendant ces années-là et que l'on s'est assuré de ne faire aucun chèque sans provision.
«De fait, si on fait faillite à 30 ans et qu'à 32 ans, on trouve un bon emploi, on peut facilement se procurer une nouvelle carte de crédit. Il suffit d'éviter d'aller à la banque à qui on devait de l'argent», relève Clémence Gagnon, conseillère budgétaire à l'ACEF de Québec.
Les magasins sont particulièrement prompts à donner des cartes au premier venu, note Marie Lachance, professeure en sciences de la consommation à l'Université Laval. «Ils offrent 10% de rabais sur l'achat du jour ou un petit stylo, et beaucoup de gens prennent la carte de crédit seulement pour le cadeau.»
Pénalisée?
Maintenant au fait de tout cela, Gisèle, elle, est la première à regretter d'en avoir fait une question d'honneur et de ne pas avoir déposé son bilan. En lieu et place, elle a fait une proposition à ses créanciers, qui ont été payés à 92%, raconte-t-elle. Elle en a pour cinq ans à les rembourser. Ensuite commenceront les années au cours desquelles elle aura à se rebâtir un crédit, tout comme quelqu'un qui a fait faillite. Bref, ça n'en finit plus. «J'ai été très mal conseillée. Mon conseil à ceux qui se seraient retrouvés dans ma situation, c'est le suivant: si vous avez de grosses dettes et n'avez aucun actif à protéger, déclarez faillite. Si je l'avais fait, j'aurais recommencé à zéro, et au lieu de peiner à rembourser mes dettes, j'aurais mis de l'argent de côté.»
(Fait à noter, cependant: une personne qui a fait faillite peut être tenue, dans les neuf mois suivants, de verser une partie de ses revenus mensuels nets s'ils excèdent la limite déterminée par les normes du Bureau du surintendant des faillites. Pour un célibataire, le coût de la vie est évalué à 1884$ par mois. S'il gagne 2184$, il devra rembourser 50% des 300$ excédentaires, donc 150$ par mois.)
«Le but de la Loi sur la faillite, dit le syndic Martin Poirier, c'est de faire en sorte qu'un individu redevienne productif pour la société. Personne ne se glorifie de faire faillite, mais il y a des gens que ça affecte moralement plus que d'autres.»
Il trouve lui aussi regrettable que les personnes qui décident, au lieu de déclarer faillite, de faire une proposition à leurs créanciers, au prix de sacrifices autrement plus importants, se retrouvent avec un dossier presque aussi entaché.
Cela dit, même si l'on peut se refaire un crédit en trois ans après une faillite, «c'est long, quand on est habitué d'avoir une carte de crédit, note Marie Lachance, de l'Université Laval. Et ça repousse d'autant la réalisation de rêves, comme de fonder une famille ou acheter un appartement».
***
La faillite en chiffres??
10 000 En 2015, entre 5000 et 10 000 ménages québécois de plus pourraient être forcés de déposer leur bilan. Hélène Bégin, économiste principale chez Desjardins
22,5% Le pourcentage de faillites déclarées au Canada dans la période de 12 mois prenant fin en octobre était de 22,5% plus élevé qu'à la période précédant la récession.
20,6% La proportion de consommateurs insolvables chez les 55 ans et plus a plus que quadruplé au cours des 10 dernières années, passant de 4,6% à 20,6%.
38% Pourcentage de la population active qui n'aurait aucune épargne en vue à la retraite, selon une étude de la Régie des rentes du Québec. Source: Surintendant des faillites.
Source: Sur intendant des faillites
- Fleur de Jasmin
- Intronisé au Panthéon
- Messages : 26283
- Inscription : ven. avr. 09, 2004 12:00 am
Re: Obliger la mise de côté de REER pour les particuliers
Ne te pose pas trop de question sur ta santé financière, tu vas te rendre malade et tu ne pourras plus travailler.pucinette a écrit : [...]
Moi je me pose plus de questions sur ma santé financière que ma santé physique
 Une fois qu'on a donné son opinion; il serait logique qu'on ne l'ait plus. (Albert Brie)
Une fois qu'on a donné son opinion; il serait logique qu'on ne l'ait plus. (Albert Brie) 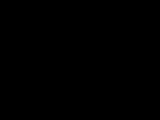
La pudeur sied bien à tout le monde; mais il faut savoir la vaincre et jamais la perdre. (Montesquieu)
Re: Obliger la mise de côté de REER pour les particuliers
Fleur de Jasmin a écrit : [...]
Ne te pose pas trop de question sur ta santé financière, tu vas te rendre malade et tu ne pourras plus travailler.
C'est drôle que tu me dises que j'ai mauvais caractère parce que si tu parles à ceux qui me traitent avec respect et courtoisie et qui ne me mentent pas et qui ne tentent pas de me f******, ils vont probablement te dire qu'au contraire je suis très gentil- Jean-François Mercier
Re: Obliger la mise de côté de REER pour les particuliers
C'est bien pour cela que je ne me pose plus de questions quant à ma sécurité financière, c'est bien plus le côté santé qui m'inquiète, si j'ai la santé, le reste viendra avec, mais sans la santé, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire.Fleur de Jasmin a écrit : [...]
Ne te pose pas trop de question sur ta santé financière, tu vas te rendre malade et tu ne pourras plus travailler.
Re: Obliger la mise de côté de REER pour les particuliers
Soleil47 a écrit : Ainsi, certaines personnes (dont l ’ex-ministre Claude Castongay) croient que le gouvernement devrait obliger les citoyens à mettre de l’argent de côté pour leurs vieux jours, car la majorité des gens ne sont pas assez intelligents pour le faire par eux-mêmes
Dans le fond, ce qu'il dit Martineau, c'est qu'il reproche au gouvernement de penser que les gens sont pas assez intelligents pour le faire par eux-mêmes, alors le Gouvernement décide d'obliger les citoyens à contribuer aux Reer.
Et il dit aussi: tant qu'à vouloir gérer les citoyens, gérons les jusqu'au bout!.
Je l'avais compris... je trouve ça mal écrit et botché quand même...
Re: Obliger la mise de côté de REER pour les particuliers
Je te dirais bien franchement que je ne me suis pas arrêté à la qualité du textePlaceress a écrit : [...]
Je l'avais compris... je trouve ça mal écrit et botché quand même...
Re: Obliger la mise de côté de REER pour les particuliers
Caricature de Garnotte du Devoir

Québec rejette le REER obligatoire proposé par Castonguay

Québec rejette le REER obligatoire proposé par Castonguay
Re: Obliger la mise de côté de REER pour les particuliers
Publié le 18 janvier 2011 à 17h30 | Mis à jour à 18h39
Retraites: l'ancien ministre Castonguay critique l'égoïsme des élus
Martin Ouellet
La Presse Canadienne
Québec
Assurés d'empocher une généreuse pension, les élus québécois ne s'intéressent pas au sort peu enviable qui attend des millions de futurs retraités, fulmine l'ancien ministre libéral Claude Castonguay.
Le père de l'assurance maladie n'a pas du tout apprécié l'accueil glacial réservé par le gouvernement à son rapport sur les pensions, présenté il y a une semaine par le Centre de recherche en analyse des organisations (CIRANO).
«Dans les heures suivant la publication de mon rapport, les ministres (Jean-Marc) Fournier, (Julie) Boulet et (Nathalie) Normandeau ont réagi, sans réfléchir, et en faisant fi de la longue tradition du Parti libéral du Québec en matière de politique sociale», dénonce M. Castonguay dans une lettre publique transmise mardi à La Presse Canadienne.
Dans son rapport d'une quarantaine de pages rendu public le 11 janvier, M. Castonguay recommande la création d'un régime d'épargne obligatoire pour les travailleurs privés d'un programme de retraite avec leur employeur.
Pour éviter une chute de leur niveau de vie une fois à la retraite, le rapport suggère que ces travailleurs, à partir de l'âge de 35 ans, soient tenus de cotiser cinq pour cent de leur revenu de travail dans un RÉER.
La recommandation, assimilée à une nouvelle taxe par certains, a aussitôt été rejetée non seulement par le gouvernement libéral mais aussi par l'opposition officielle et l'Action démocratique.
Un porte-parole de la ministre responsable, Julie Boulet, s'est chargé de sceller le sort du rapport la semaine dernière en laissant savoir que le gouvernement n'avait pas l'intention de forcer les citoyens à mettre de l'argent de côté.
Pendant que le gouvernement reste les bras croisés, «plus de deux millions et demi» de travailleurs se dirigent vers une importante baisse de leur niveau de vie à la retraite, déplore M. Castonguay dans sa lettre aux journaux.
«Pitoyable»
«Face à une telle perspective, comment réagissent le gouvernement et les partis d'opposition? Le gouvernement propose le maintien du statu quo, c'est-à-dire absolument rien. De leur côté, les partis d'opposition répondent par des voeux pieux. De la part de ministres et de députés qui vont bénéficier de généreuses pensions, c'est pitoyable», écrit l'ex-ministre.
«Mes détracteurs sont-ils conscients que si rien n'est fait, ce sont ceux qui auront fait preuve de prévoyance et les travailleurs de demain, en nombre réduit, qui paieront pour les imprévoyants», poursuit celui qui a présidé le groupe de travail sur le financement du système de santé du Québec en 2007 et 2008.
Joint par La Presse Canadienne, l'octogénaire en a remis contre le gouvernement Charest à qui il reproche de s'être braqué sans rien proposer de valable en retour.
«J'ai trouvé que c'était des gens qui n'ont pas grand-chose à dire. Au lieu d'essayer de répondre avec un peu de substance, ils ont essayé de clore le débat et de fermer la porte. Mais comme ils n'ont rien de valable à proposer, je crois que le débat va se poursuivre. Ce n'est pas en niant l'existence du problème qu'on va le faire disparaître», a-t-il dit.
Du reste, selon M. Castonguay, la ministre de l'Emploi Julie Boulet se berce d'illusions si elle croit que la mise sur pied d'un régime multiemployeurs va régler le problème des centaines de milliers de salariés et de travailleurs autonomes mal préparés pour la retraite.
Échaudé par la critique, paralysé par la peur de déplaire, le gouvernement du Québec n'ose plus offrir quoi que ce soit de neuf sur le plan social, se désole l'ancien ministre de la Santé, artisan de la Révolution tranquille.
«Ils ont été tellement brassés qu'on dirait qu'ils ne sont plus capables de réagir autrement qu'en prônant le statu quo. Ils ont peur de toute réaction venant de la population», a-t-il analysé.
http://www.cyberpresse.ca/actualites/qu ... cueil_POS1" onclick="window.open(this.href);return false;
Retraites: l'ancien ministre Castonguay critique l'égoïsme des élus
Martin Ouellet
La Presse Canadienne
Québec
Assurés d'empocher une généreuse pension, les élus québécois ne s'intéressent pas au sort peu enviable qui attend des millions de futurs retraités, fulmine l'ancien ministre libéral Claude Castonguay.
Le père de l'assurance maladie n'a pas du tout apprécié l'accueil glacial réservé par le gouvernement à son rapport sur les pensions, présenté il y a une semaine par le Centre de recherche en analyse des organisations (CIRANO).
«Dans les heures suivant la publication de mon rapport, les ministres (Jean-Marc) Fournier, (Julie) Boulet et (Nathalie) Normandeau ont réagi, sans réfléchir, et en faisant fi de la longue tradition du Parti libéral du Québec en matière de politique sociale», dénonce M. Castonguay dans une lettre publique transmise mardi à La Presse Canadienne.
Dans son rapport d'une quarantaine de pages rendu public le 11 janvier, M. Castonguay recommande la création d'un régime d'épargne obligatoire pour les travailleurs privés d'un programme de retraite avec leur employeur.
Pour éviter une chute de leur niveau de vie une fois à la retraite, le rapport suggère que ces travailleurs, à partir de l'âge de 35 ans, soient tenus de cotiser cinq pour cent de leur revenu de travail dans un RÉER.
La recommandation, assimilée à une nouvelle taxe par certains, a aussitôt été rejetée non seulement par le gouvernement libéral mais aussi par l'opposition officielle et l'Action démocratique.
Un porte-parole de la ministre responsable, Julie Boulet, s'est chargé de sceller le sort du rapport la semaine dernière en laissant savoir que le gouvernement n'avait pas l'intention de forcer les citoyens à mettre de l'argent de côté.
Pendant que le gouvernement reste les bras croisés, «plus de deux millions et demi» de travailleurs se dirigent vers une importante baisse de leur niveau de vie à la retraite, déplore M. Castonguay dans sa lettre aux journaux.
«Pitoyable»
«Face à une telle perspective, comment réagissent le gouvernement et les partis d'opposition? Le gouvernement propose le maintien du statu quo, c'est-à-dire absolument rien. De leur côté, les partis d'opposition répondent par des voeux pieux. De la part de ministres et de députés qui vont bénéficier de généreuses pensions, c'est pitoyable», écrit l'ex-ministre.
«Mes détracteurs sont-ils conscients que si rien n'est fait, ce sont ceux qui auront fait preuve de prévoyance et les travailleurs de demain, en nombre réduit, qui paieront pour les imprévoyants», poursuit celui qui a présidé le groupe de travail sur le financement du système de santé du Québec en 2007 et 2008.
Joint par La Presse Canadienne, l'octogénaire en a remis contre le gouvernement Charest à qui il reproche de s'être braqué sans rien proposer de valable en retour.
«J'ai trouvé que c'était des gens qui n'ont pas grand-chose à dire. Au lieu d'essayer de répondre avec un peu de substance, ils ont essayé de clore le débat et de fermer la porte. Mais comme ils n'ont rien de valable à proposer, je crois que le débat va se poursuivre. Ce n'est pas en niant l'existence du problème qu'on va le faire disparaître», a-t-il dit.
Du reste, selon M. Castonguay, la ministre de l'Emploi Julie Boulet se berce d'illusions si elle croit que la mise sur pied d'un régime multiemployeurs va régler le problème des centaines de milliers de salariés et de travailleurs autonomes mal préparés pour la retraite.
Échaudé par la critique, paralysé par la peur de déplaire, le gouvernement du Québec n'ose plus offrir quoi que ce soit de neuf sur le plan social, se désole l'ancien ministre de la Santé, artisan de la Révolution tranquille.
«Ils ont été tellement brassés qu'on dirait qu'ils ne sont plus capables de réagir autrement qu'en prônant le statu quo. Ils ont peur de toute réaction venant de la population», a-t-il analysé.
http://www.cyberpresse.ca/actualites/qu ... cueil_POS1" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Obliger la mise de côté de REER pour les particuliers
Finances personnelles
Les jeunes Canadiens se désintéressent des REER
Agence QMI
19/01/2011 11h36

TORONTO – Le REER est de moins en moins populaire chez les Canadiens de 18 à 34 ans, selon un sondage publié mercredi par RBC.
La proportion de Canadiens appartenant à cette tranche d’âge et qui disposent d’un REER a en effet atteint 39 %, son niveau le plus bas depuis près de 10 ans. Qui plus est, ajoute la RBC, près 45 % des membres de ce groupe n'ont pas encore commencé à mettre de l’argent de côté pour leur retraite.
«De plus en plus, d'autres priorités financières prennent davantage d'importance pour les jeunes Canadiens qui ne se rendent peut-être pas compte qu'en ne souscrivant pas à un REER, ils se privent de l'un des meilleurs instruments d'épargne au Canada», a indiqué mercredi Lee Anne Davies, chef, Stratégies de retraite, RBC.
En effet, l'épargne-retraite n’arrive pas en tête de liste de leurs priorités financières: elle n’occupe que le septième rang. Les jeunes Canadiens se soucient bien plus du remboursement de leurs dettes (56 %), de l'épargne pour les temps difficiles (45 %) et de l'accession à la propriété (44 %).
Le sondage de RBC soulève par ailleurs un point intéressant: acheter un logement préoccupe les jeunes, mais ce n’est pas pour autant qu’ils profitent des avantages offerts par les REER par le biais du Régime d'accès à la propriété (RAP).
Le RAP permet de prélever jusqu'à 25 000 $ sur le REER afin de financer l'achat d'une maison neuve ou existante.
Les conclusions de cette étude confirment en tout cas la tendance à la baisse observée dans la précédente édition du sondage, ainsi que dans un rapport de Recherche économique RBC publié en janvier 2010.
Le sondage a été mené en ligne par Ipsos Reid, du 29 octobre au 4 novembre 2010, auprès de 1457 adultes canadiens, parmi lesquels 184 étaient âgés de 18 à 34 ans.
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/a ... 13640.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Les jeunes Canadiens se désintéressent des REER
Agence QMI
19/01/2011 11h36

TORONTO – Le REER est de moins en moins populaire chez les Canadiens de 18 à 34 ans, selon un sondage publié mercredi par RBC.
La proportion de Canadiens appartenant à cette tranche d’âge et qui disposent d’un REER a en effet atteint 39 %, son niveau le plus bas depuis près de 10 ans. Qui plus est, ajoute la RBC, près 45 % des membres de ce groupe n'ont pas encore commencé à mettre de l’argent de côté pour leur retraite.
«De plus en plus, d'autres priorités financières prennent davantage d'importance pour les jeunes Canadiens qui ne se rendent peut-être pas compte qu'en ne souscrivant pas à un REER, ils se privent de l'un des meilleurs instruments d'épargne au Canada», a indiqué mercredi Lee Anne Davies, chef, Stratégies de retraite, RBC.
En effet, l'épargne-retraite n’arrive pas en tête de liste de leurs priorités financières: elle n’occupe que le septième rang. Les jeunes Canadiens se soucient bien plus du remboursement de leurs dettes (56 %), de l'épargne pour les temps difficiles (45 %) et de l'accession à la propriété (44 %).
Le sondage de RBC soulève par ailleurs un point intéressant: acheter un logement préoccupe les jeunes, mais ce n’est pas pour autant qu’ils profitent des avantages offerts par les REER par le biais du Régime d'accès à la propriété (RAP).
Le RAP permet de prélever jusqu'à 25 000 $ sur le REER afin de financer l'achat d'une maison neuve ou existante.
Les conclusions de cette étude confirment en tout cas la tendance à la baisse observée dans la précédente édition du sondage, ainsi que dans un rapport de Recherche économique RBC publié en janvier 2010.
Le sondage a été mené en ligne par Ipsos Reid, du 29 octobre au 4 novembre 2010, auprès de 1457 adultes canadiens, parmi lesquels 184 étaient âgés de 18 à 34 ans.
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/a ... 13640.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Obliger la mise de côté de REER pour les particuliers
Retraite: des idées pour le Québec
Publié le 19 février 2011 à 05h00 | Mis à jour à 05h00
Stéphanie Grammond
La Presse
Doit-on forcer les travailleurs à épargner, comme en Suède? Peut-on imposer la création d'un régime de retraite dans toutes les entreprises, comme en Norvège? Dans la troisième et dernière partie de notre reportage sur la réforme des retraites à la mode scandinave, La Presse Affaires se penche sur les solutions qui pourraient être importées au Québec et au Canada...
La campagne REER? Les Norvégiens ne stressent pas avec ça! Ils savent que leur régime de retraite suffira. Ils dépensent tout leur salaire. La fin de semaine, ils vont magasiner en Suède, où des centres d'achats les attendent juste de l'autre côté de la frontière. Il existe même une expression pour ces expéditions: Harry Tur, ou «voyage quétaine», parce que les gens ont un peu honte. «Mais ils peuvent économiser presque 50% sur la viande et l'alcool», raconte Kristine Thelle, attablée au LitteratureHuset, un restaurant/librairie au coeur d'Oslo.
Norvégienne «pure laine», Kristine Thelle est bien placée pour comparer le Québec et la Norvège car son conjoint est Québécois. Oui, tout coûte très cher en Norvège, convient la mère de trois enfants. Mais la qualité de vie est fantastique. Les salaires sont nettement supérieurs. Les journées de travail sont moins longues. En comptant les fériés, il y a pratiquement huit semaines de congé par année. Et les travailleurs n'ont pas à se casser la tête avec la retraite, comme au Québec.
«Le contrat social est plus généreux. Les individus n'ont pas autant de pression pour préparer la retraite en Norvège. C'est ça, la structure sociale démocratique», confirme Carl Bang. Établi à Montréal, le Norvégien d'origine a dirigé la filiale du géant State Street, au Canada et en France.
Au Canada, il y a un gros manque, constate le financier. «Dans 20 ans, la faiblesse va ressortir, prédit-il. Une partie de la population n'aura pas un niveau de vie qui est souhaitable.»
Les limites de l'État
Contrairement aux Scandinaves et aux Européens en général, les Canadiens ne peuvent pas se fier sur l'État pour la retraite... sauf les moins nantis.
En fait, le Canada est un champion de la lutte à la pauvreté chez les aînés. Moins de 5% des personnes âgées de plus de 65 ans vivent sous le seuil de la pauvreté, par rapport à 13% pour les pays de l'OCDE, et à 24% aux États-Unis.
Les travailleurs qui gagnent moins que 25 000$ n'ont pas trop à s'en faire. Les programmes gouvernementaux leur fourniront, à 65 ans, l'équivalent d'au moins 70% de leurs revenus d'emploi.
Il en va tout autrement pour la classe moyenne et supérieure. Pour un salarié qui gagne 60 000$, par exemple, la Régie des rentes du Québec (RRQ), la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) et le supplément de revenu garanti (SRG) ne remplaceront que le tiers des revenus d'emploi, à 65 ans.
Autrement dit, les travailleurs qui gagnent présentement 60 000$ ou davantage devront se contenter de moins de 20 000$ à la retraite, s'ils n'ont pas d'autres ressources. Un choc.
Les patrons démissionnent
Dans le passé, les employés pouvaient compter sur le régime complémentaire de retraite de leur employeur. Mais ces régimes sont en voie de disparition. Au début des années 90, presque la moitié de la main-d'oeuvre (45%) était couverte. Désormais, ce n'est plus que 38%... essentiellement des employés de la fonction publique ou de grandes entreprises.
Dans le secteur privé, plus des trois quarts (76%) des travailleurs n'ont aucun régime de retraite, indique Patrik Marier, professeur à l'Université Concordia. On pense surtout aux travailleurs autonomes, aux employés de PME...
«Chez les jeunes, la proportion est encore plus élevée, ce qui est particulièrement alarmant», précise M. Marier dans une étude intitulée Improving Canada's Retirement Saving.
Et le trou dans la couverture privée de retraite ne cesse de s'élargir, car beaucoup d'entreprises réduisent ou abolissent leur régime, les jugeant trop lourds à porter.
L'échec du REER
Le fardeau retombe sur les épaules des travailleurs qui doivent se débrouiller seuls pour la retraite. Pour avoir l'équivalent d'un bon régime de retraite, ils doivent cotiser au maximum à leur REER, en y versant 18% de leur salaire chaque année. Mais seule une infime minorité le fait.
Seulement le tiers (31%) des contribuables admissibles cotisent à leur REER, pour une contribution médiane d'environ 2 800$, ce qui ne représente un maigre 6% des droits de totaux disponibles, selon le Groupe de travail sur la littératie financière.
Mais il y a pire: «Un nombre élevé de cotisants retirent, pour d'autres fins que la retraite, les sommes accumulées dans leur REER avant la retraite», indique l'actuaire Claude Castonguay, dans Le Point sur les pensions.
Ainsi, malgré 50 ans d'existence, le REER reste une source de revenu marginale pour les retraités qui en tirent moins de 2% de revenus totaux.
Si rien n'est fait, la moitié des travailleurs subira une baisse significative de son niveau de vie à la retraite, calcule la RRQ.
«Il est urgent d'agir, sinon il y aura un problème encore plus criant au Québec dans 20 ans», insiste M. Marier.
Les baby-boomers en souffriront, bien sûr. «Mais les gens de 40 ans sont dans une situation bien plus grave», estime M. Marier. Plusieurs n'ont jamais eu de régime de retraite de leur vie. Ils ont payé leur maison très cher, ce qui limite leur capacité d'épargner pour la retraite.
Le modèle scandinave
En Scandinavie, les politiciens ont pris le taureau par les cornes.
La Norvège a forcé tous les employeurs à offrir un régime de retraite. Depuis 2006, chaque entreprise doit y verser au moins 2% du salaire de ses employés. La contrainte a rapidement été digérée par les sociétés, y
compris les PME qui n'étaient pas très contentes au départ.
Cette solution a le mérite de couvrir tous les travailleurs avec un régime simple et peu coûteux en frais de gestion. Mais au Canada, un tel modèle rencontrerait une vive opposition de la part de l'industrie des services financiers, car il ferait concurrence au REER, prédit M. Marier.
Forcer les employeurs à contribuer à la retraite de leurs employés est loin de faire l'unanimité. À peine sorti de la récession, certains craignent qu'un fardeau additionnel ne nuise à leur compétitivité sur la scène internationale.
De son côté, la Suède a intégré à son régime public des comptes de retraite individuels qui prévoient des contributions obligatoires de 2,5% du salaire (partagée entre l'employeur et l'employé).
Tel quel, le système a peu de chance de faire école au Canada, croit M. Marier. L'idée d'insérer une composante privée à l'intérieur de la RRQ a déjà été abordée, mais elle a fait long feu. «Pour que ça fonctionne, il faudrait que ces comptes privés soient au-dessus de la RRQ, dit-il. Et le taux de cotisation devrait être bien plus haut que 2,5%.»
Mais l'épargne forcée n'a pas la cote au Québec. Tous les partis politiques ont rejeté en bloc l'idée d'un REER obligatoire, proposée par Claude Castonguay en janvier.
Des kiwis pour la retraite
Le Groupe de travail sur la littératie financière, formé par le ministre des Finances du Canada, préconise plutôt une formule hybride. Dans son rapport publié la semaine dernière, il recommande, «que les employeurs offrent des programmes et des outils d'épargne automatique afin d'encourager les Canadiens à pratiquer l'épargne durant toute leur vie.»
Les études sur le comportement démontrent que les gens savent qu'ils doivent épargner, planifier leur retraite, suivrent leur portefeuille... mais que l'inertie les empêchent souvent de passer aux actes.
Au lieu de les forcer, on peut mettre en place un mécanisme d'adhésion automatique assortie d'une option de retrait pour ceux qui refusent de participer. En milieu de travail, un régime de retraite doté d'un tel système permet d'atteindre rapidement un taux de participation de presque 100%, contre seulement 65% après trois ans avec une formule classique d'adhésion volontaire, démontrent des études.
Le Royaume-Uni doit lancer une formule semblable, en 2012. La Nouvelle-Zélande l'a fait en 2007. Depuis, tous les nouveaux travailleurs adhèrent automatiquement à un régime de retraite baptisé KiwiSaver. Mais ils peuvent s'en retirer au cours des premières semaines suivant leur embauche. Les contributions minimales sont de 4% du salaire, partagées entre l'employeur et l'employé. Les sommes sont investies dans une solution de placement par défaut, mais les individus ont le choix d'investir ailleurs.
Est-ce la panacée? Il s'agit d'un compromis intéressant entre l'épargne volontaire et obligatoire. «Mais pour être optimale, l'adhésion automatique nécessite des mesures incitatives additionnelles», dit M. Marier.
Mais peu importe la solution qui sera retenue, l'important est d'agir vite... et de ne pas s'enfarger dans les fleurs du tapis.
«Le gros problème dans tous les pays, c'est que l'on commence par discuter des détails techniques», fait remarquer Karl Gustaf Scherman, ancien directeur l'Agence de retraite suédoise. «Mais la première question est: Quand vous serez vieux, voudrez-vous maintenir un niveau de vie raisonnable?» Si oui, il faudra payer le prix.
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/ ... cueil_POS2" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié le 19 février 2011 à 05h00 | Mis à jour à 05h00
Stéphanie Grammond
La Presse
Doit-on forcer les travailleurs à épargner, comme en Suède? Peut-on imposer la création d'un régime de retraite dans toutes les entreprises, comme en Norvège? Dans la troisième et dernière partie de notre reportage sur la réforme des retraites à la mode scandinave, La Presse Affaires se penche sur les solutions qui pourraient être importées au Québec et au Canada...
La campagne REER? Les Norvégiens ne stressent pas avec ça! Ils savent que leur régime de retraite suffira. Ils dépensent tout leur salaire. La fin de semaine, ils vont magasiner en Suède, où des centres d'achats les attendent juste de l'autre côté de la frontière. Il existe même une expression pour ces expéditions: Harry Tur, ou «voyage quétaine», parce que les gens ont un peu honte. «Mais ils peuvent économiser presque 50% sur la viande et l'alcool», raconte Kristine Thelle, attablée au LitteratureHuset, un restaurant/librairie au coeur d'Oslo.
Norvégienne «pure laine», Kristine Thelle est bien placée pour comparer le Québec et la Norvège car son conjoint est Québécois. Oui, tout coûte très cher en Norvège, convient la mère de trois enfants. Mais la qualité de vie est fantastique. Les salaires sont nettement supérieurs. Les journées de travail sont moins longues. En comptant les fériés, il y a pratiquement huit semaines de congé par année. Et les travailleurs n'ont pas à se casser la tête avec la retraite, comme au Québec.
«Le contrat social est plus généreux. Les individus n'ont pas autant de pression pour préparer la retraite en Norvège. C'est ça, la structure sociale démocratique», confirme Carl Bang. Établi à Montréal, le Norvégien d'origine a dirigé la filiale du géant State Street, au Canada et en France.
Au Canada, il y a un gros manque, constate le financier. «Dans 20 ans, la faiblesse va ressortir, prédit-il. Une partie de la population n'aura pas un niveau de vie qui est souhaitable.»
Les limites de l'État
Contrairement aux Scandinaves et aux Européens en général, les Canadiens ne peuvent pas se fier sur l'État pour la retraite... sauf les moins nantis.
En fait, le Canada est un champion de la lutte à la pauvreté chez les aînés. Moins de 5% des personnes âgées de plus de 65 ans vivent sous le seuil de la pauvreté, par rapport à 13% pour les pays de l'OCDE, et à 24% aux États-Unis.
Les travailleurs qui gagnent moins que 25 000$ n'ont pas trop à s'en faire. Les programmes gouvernementaux leur fourniront, à 65 ans, l'équivalent d'au moins 70% de leurs revenus d'emploi.
Il en va tout autrement pour la classe moyenne et supérieure. Pour un salarié qui gagne 60 000$, par exemple, la Régie des rentes du Québec (RRQ), la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) et le supplément de revenu garanti (SRG) ne remplaceront que le tiers des revenus d'emploi, à 65 ans.
Autrement dit, les travailleurs qui gagnent présentement 60 000$ ou davantage devront se contenter de moins de 20 000$ à la retraite, s'ils n'ont pas d'autres ressources. Un choc.
Les patrons démissionnent
Dans le passé, les employés pouvaient compter sur le régime complémentaire de retraite de leur employeur. Mais ces régimes sont en voie de disparition. Au début des années 90, presque la moitié de la main-d'oeuvre (45%) était couverte. Désormais, ce n'est plus que 38%... essentiellement des employés de la fonction publique ou de grandes entreprises.
Dans le secteur privé, plus des trois quarts (76%) des travailleurs n'ont aucun régime de retraite, indique Patrik Marier, professeur à l'Université Concordia. On pense surtout aux travailleurs autonomes, aux employés de PME...
«Chez les jeunes, la proportion est encore plus élevée, ce qui est particulièrement alarmant», précise M. Marier dans une étude intitulée Improving Canada's Retirement Saving.
Et le trou dans la couverture privée de retraite ne cesse de s'élargir, car beaucoup d'entreprises réduisent ou abolissent leur régime, les jugeant trop lourds à porter.
L'échec du REER
Le fardeau retombe sur les épaules des travailleurs qui doivent se débrouiller seuls pour la retraite. Pour avoir l'équivalent d'un bon régime de retraite, ils doivent cotiser au maximum à leur REER, en y versant 18% de leur salaire chaque année. Mais seule une infime minorité le fait.
Seulement le tiers (31%) des contribuables admissibles cotisent à leur REER, pour une contribution médiane d'environ 2 800$, ce qui ne représente un maigre 6% des droits de totaux disponibles, selon le Groupe de travail sur la littératie financière.
Mais il y a pire: «Un nombre élevé de cotisants retirent, pour d'autres fins que la retraite, les sommes accumulées dans leur REER avant la retraite», indique l'actuaire Claude Castonguay, dans Le Point sur les pensions.
Ainsi, malgré 50 ans d'existence, le REER reste une source de revenu marginale pour les retraités qui en tirent moins de 2% de revenus totaux.
Si rien n'est fait, la moitié des travailleurs subira une baisse significative de son niveau de vie à la retraite, calcule la RRQ.
«Il est urgent d'agir, sinon il y aura un problème encore plus criant au Québec dans 20 ans», insiste M. Marier.
Les baby-boomers en souffriront, bien sûr. «Mais les gens de 40 ans sont dans une situation bien plus grave», estime M. Marier. Plusieurs n'ont jamais eu de régime de retraite de leur vie. Ils ont payé leur maison très cher, ce qui limite leur capacité d'épargner pour la retraite.
Le modèle scandinave
En Scandinavie, les politiciens ont pris le taureau par les cornes.
La Norvège a forcé tous les employeurs à offrir un régime de retraite. Depuis 2006, chaque entreprise doit y verser au moins 2% du salaire de ses employés. La contrainte a rapidement été digérée par les sociétés, y
compris les PME qui n'étaient pas très contentes au départ.
Cette solution a le mérite de couvrir tous les travailleurs avec un régime simple et peu coûteux en frais de gestion. Mais au Canada, un tel modèle rencontrerait une vive opposition de la part de l'industrie des services financiers, car il ferait concurrence au REER, prédit M. Marier.
Forcer les employeurs à contribuer à la retraite de leurs employés est loin de faire l'unanimité. À peine sorti de la récession, certains craignent qu'un fardeau additionnel ne nuise à leur compétitivité sur la scène internationale.
De son côté, la Suède a intégré à son régime public des comptes de retraite individuels qui prévoient des contributions obligatoires de 2,5% du salaire (partagée entre l'employeur et l'employé).
Tel quel, le système a peu de chance de faire école au Canada, croit M. Marier. L'idée d'insérer une composante privée à l'intérieur de la RRQ a déjà été abordée, mais elle a fait long feu. «Pour que ça fonctionne, il faudrait que ces comptes privés soient au-dessus de la RRQ, dit-il. Et le taux de cotisation devrait être bien plus haut que 2,5%.»
Mais l'épargne forcée n'a pas la cote au Québec. Tous les partis politiques ont rejeté en bloc l'idée d'un REER obligatoire, proposée par Claude Castonguay en janvier.
Des kiwis pour la retraite
Le Groupe de travail sur la littératie financière, formé par le ministre des Finances du Canada, préconise plutôt une formule hybride. Dans son rapport publié la semaine dernière, il recommande, «que les employeurs offrent des programmes et des outils d'épargne automatique afin d'encourager les Canadiens à pratiquer l'épargne durant toute leur vie.»
Les études sur le comportement démontrent que les gens savent qu'ils doivent épargner, planifier leur retraite, suivrent leur portefeuille... mais que l'inertie les empêchent souvent de passer aux actes.
Au lieu de les forcer, on peut mettre en place un mécanisme d'adhésion automatique assortie d'une option de retrait pour ceux qui refusent de participer. En milieu de travail, un régime de retraite doté d'un tel système permet d'atteindre rapidement un taux de participation de presque 100%, contre seulement 65% après trois ans avec une formule classique d'adhésion volontaire, démontrent des études.
Le Royaume-Uni doit lancer une formule semblable, en 2012. La Nouvelle-Zélande l'a fait en 2007. Depuis, tous les nouveaux travailleurs adhèrent automatiquement à un régime de retraite baptisé KiwiSaver. Mais ils peuvent s'en retirer au cours des premières semaines suivant leur embauche. Les contributions minimales sont de 4% du salaire, partagées entre l'employeur et l'employé. Les sommes sont investies dans une solution de placement par défaut, mais les individus ont le choix d'investir ailleurs.
Est-ce la panacée? Il s'agit d'un compromis intéressant entre l'épargne volontaire et obligatoire. «Mais pour être optimale, l'adhésion automatique nécessite des mesures incitatives additionnelles», dit M. Marier.
Mais peu importe la solution qui sera retenue, l'important est d'agir vite... et de ne pas s'enfarger dans les fleurs du tapis.
«Le gros problème dans tous les pays, c'est que l'on commence par discuter des détails techniques», fait remarquer Karl Gustaf Scherman, ancien directeur l'Agence de retraite suédoise. «Mais la première question est: Quand vous serez vieux, voudrez-vous maintenir un niveau de vie raisonnable?» Si oui, il faudra payer le prix.
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/ ... cueil_POS2" onclick="window.open(this.href);return false;