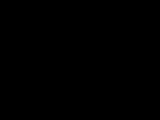Nounou1 a écrit
Questions
Denise Bombardier
Édition du samedi 24 et du dimanche 25 septembre 2005
Mots clés : Québec (province), Gouvernement, consommation de cocaïne
Que faut-il penser d'un homme de quarante ans qui ambitionne de diriger le Québec un jour et de le mener à sa souveraineté et qui explique, comme excuse à sa consommation de cocaïne alors qu'il occupait des fonctions ministérielles, qu'il aime le plaisir, qu'il adore s'amuser et que son aveu indique qu'il est «généreux de sa vie privée»? Que penser d'un futur président d'un Québec indépendant qui considère une atteinte à son «intégrité physique» une bousculade, inélégante certes, avec les journalistes qui veulent l'interroger? Comment doit-on réagir lorsqu'on le voit, le regard noir, accuser ses adversaires, compagnons d'armes de la souveraineté, de délation se transformant de la sorte en victime de ces méchants alors qu'il est coupable de ses propres errements?
Que dire d'un État de droit où l'on découvre soudain dans la population une permissivité élastique face à un geste condamné lourdement par le Code criminel au prétexte que «la cocaïne, tout le monde le fun en a pris un jour» ?
Comment réagir devant tant de gens qui refusent désormais de juger une personne publique à ses actes afin, suppose-t-on, qu'on leur rende éventuellement la pareille, créant par le fait même un nouveau concept, celui de l'impunité à tout prix ?
Que dire de ceux qui crient haut et fort qu'une attaque à l'endroit d'André Boisclair est une attaque contre la génération à laquelle il appartient, comme si le candidat à la direction de son parti incarnait les valeurs, les croyances et les idéaux de toute sa classe d'âge ?
Que penser d'un parti politique dont l'arrogance s'est souvent drapée de vertus, qui n'a que le mot liberté à la bouche et qui organise un débat, mercredi dernier, au cours duquel un lourd silence sera de mise sur l'événement majeur de la semaine ?
Que penser des citoyens qui traitent de puritains et de Mère Teresa les journalistes exerçant leur rôle de «chiens de garde» de la démocratie qui continuent de poser des questions pour que la vérité soit faite ?
Dans quelle société vivons-nous pour que l'aveu d'un geste de nature criminelle propulse la personne qui l'a posé plus avant dans le concours de popularité et que celle dont on suppose l'entourage d'avoir laissé filtrer la nouvelle perde des appuis ?
La loi du nombre serait-elle à ce point incontournable que les principes, les valeurs et la morale devraient désormais être définis par cette loi du plus grand nombre ? De même qu'il faudrait en parler parce que «tout le monde en parle», il faudrait effacer cet égarement ministériel parce que tout le monde, apparemment, a consommé de la drogue. On est ahuri lorsqu'on entend des adversaires haineux de George W. Bush, le citer comme exemple de consommation de drogue pour excuser la consommation de M. Boisclair. On demeure éberlué devant l'incapacité à distinguer une activité illicite privée d'une activité illégale exercée dans une fonction publique, et qui plus est, alors qu'on est membre d'un gouvernement. Oublie-t-on que l'élu est le seul représentant du peuple et que ce titre lui confère une responsabilité unique, lui assure une immunité à l'intérieur de l'Assemblée nationale mais l'oblige à une rectitude morale ? Qu'est-ce donc que cet argument foutaise exprimé par certains esprits plus fêlés qu'affranchis selon lequel ceux qui nous gouvernent ne doivent pas être des saints ou des Mères Teresa auquel cas ils seraient dangereux. Que ceux-là n'aient crainte. Moult dictateurs et tyrans sont des partouzards redoutables, pratiquant le droit de cuissage, l'élimination physique des adversaires et qui se défoncent à l'alcool et aux drogues dont ils contrôlent souvent eux-mêmes le commerce. Exiger d'être gouverné par des gens responsables et respectueux des lois ne va-t-il pas de soi en démocratie ?
Toute cette histoire, encore une fois, nous renvoie à nos démons, nos faiblesses et surtout notre désarroi lorsqu'il s'agit d'établir des règles éthiques. À vrai dire, l'on constate une réticence non seulement à juger mais à évaluer, à hiérarchiser et en fin de compte à condamner, sauf en matière de crimes crapuleux ou dans les domaines recouverts par la rectitude politique. La génération de la grande récréation des années soixante qui a brisé tous les tabous, a fait éclater les interdits, s'est soûlée au sens propre comme au figuré, a vécu sous influence psychédélique, a erré sexuellement, cette génération ne veut pas se faire juger rétrospectivement. Elle absout pour être absoute elle-même des dérapages dont elle n'est pas nécessairement fière. Cette génération a produit des enfants orphelins de repères, on ne le soulignera jamais assez. Ajoutons à cela le vieux traumatisme de la culpabilité dont on observe aujourd'hui les ravages. À lutter contre la culpabilité, on en arrive à nier son effet de catharsis. Se sentir coupable, n'est-ce pas reconnaître qu'on a été dans l'erreur ? Et l'erreur ne se répare pas par la seule volonté de celui qui l'a commise. Cela s'appelle assumer ses actes. Avec l'état d'esprit qui prévaut actuellement, ce genre de réflexion renvoie celui qui l'exprime dans un camp où l'on ne risque pas de gagner le concours de popularité.
denbombardier@videotron.ca




 Une fois qu'on a donné son opinion; il serait logique qu'on ne l'ait plus. (Albert Brie)
Une fois qu'on a donné son opinion; il serait logique qu'on ne l'ait plus. (Albert Brie)