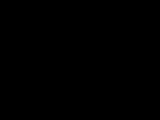Anya a écrit : Publié le 06 novembre 2010 à 06h00
Jugement Lola: la faillite du tout ou rien
 Dans une province où plus du tiers des couples vivent en union de fait (c'était le cas de Lola et Éric) et où les deux tiers des enfants sont issus de ces unions, un droit civil qui ignore ces familles au nom de la liberté contractuelle n'était tout simplement plus en phase avec la société.
Dans une province où plus du tiers des couples vivent en union de fait (c'était le cas de Lola et Éric) et où les deux tiers des enfants sont issus de ces unions, un droit civil qui ignore ces familles au nom de la liberté contractuelle n'était tout simplement plus en phase avec la société.
Marie-France Bureau
L'auteure est professeure agrégée à l'Université de Sherbrooke et enseigne le droit familial.
Dans son jugement sur la cause Lola, la Cour d'appel vient de déclarer inconstitutionnel l'article prévoyant l'obligation alimentaire entre conjoints au Code civil qui ne concernait jusqu'ici que les conjoints mariés. Il s'agit d'une décision importante au plan juridique qui aura des répercussions importantes sur la façon dont le droit réglemente les relations conjugales.
La Cour d'appel a donné raison à l'appelante concernant l'obligation alimentaire et a rejeté ses prétentions concernant le partage du patrimoine familial. Elle a déclaré inconstitutionnelle l'exclusion des conjoints de fait de la possibilité de demander une pension alimentaire en cas de séparation. De plus, elle a suspendu cette déclaration d'inconstitutionnalité pour un an de façon à permettre au législateur de choisir la façon dont il entendait remédier à cette situation.
Dans la mesure où l'ensemble des législations des provinces prévoient la possibilité pour les ex-conjoints de fait de réclamer une pension en cas de séparation, et compte tenu de l'évolution de la société quant aux formes d'unions conjugales possibles, la décision de la Cour d'appel n'est pas surprenante. Ce qui l'est davantage est le fait que plusieurs commentateurs parlent de «surprise», de «paternalisme», voire de «bombe juridique».
Les arguments selon lesquels l'État entend marier tous les conjoints contre leur gré, infantiliser les couples et victimiser les femmes nous semblent alarmistes dans les circonstances. Il ne s'agit manifestement pas d'un mariage obligatoire pour tous, mais uniquement de reconnaître les dépendances qui peuvent se créer dans le cadre de certaines unions conjugales. Certaines femmes pourront s'en prévaloir et des hommes aussi. Mais comme dans le droit actuel, le droit à la pension est toujours évalué au cas par cas en fonction de différents critères législatifs comme la durée de l'union, la fonction assumée par la partie demandant la pension, la présence d'enfants, etc.
Le débat sur le statut des conjoints de fait au Québec a débuté avant même les grandes réformes du droit de la famille des années 80. À cette époque, la situation des conjoints de fait pouvait être considérée comme étant marginale et non prioritaire. Mais aujourd'hui, dans une province où plus du tiers des couples vivent en union de fait et où les deux tiers des enfants sont issus de ces unions, un droit civil qui ignore ces familles au nom de la liberté contractuelle n'était tout simplement plus en phase avec la société.
Que l'on soit d'accord ou non avec les conclusions de la Cour d'appel, force est de reconnaître que la discussion sur le statut des conjoints de fait doit se faire. Un grand nombre de couples s'investissent dans une relation, élèvent des enfants et construisent une vie commune en dehors des liens du mariage. Ces unions sont susceptibles de créer des dépendances et des vulnérabilités comme l'État et les tribunaux le reconnaissent dans le cas du mariage.
Mais ce que cette affaire révèle, c'est la faillite du modèle du tout ou rien en matière familiale. L'État martèle depuis 30 ans le message du choix et de la liberté contractuelle pour ne pas réformer le droit matrimonial. D'un côté, il y a le mariage, avec toutes les protections, le patrimoine familial, les régimes matrimoniaux et une série d'obligations d'ordre public (qui ne conviennent d'ailleurs plus nécessairement aux couples contemporains d'aujourd'hui) et de l'autre, l'union libre. Celle qui a des relents de l'ancien droit et qui sent encore l'atteinte aux bonnes moeurs. En dehors du mariage, l'union de fait rappelle l'idée romaine du concubinage. Cette union envisagée hors du droit, de la légitimité et de la protection de la loi. Le statu quo sur ces questions était tout simplement improbable en 2010.
Une chose est certaine: le Québec doit s'interroger sur la façon d'organiser l'interdépendance, l'intimité et les unions dans la durée, et ce, peu importe la forme que ces unions peuvent prendre. Ce que l'affaire Lola et Éric met en lumière n'est finalement pas tant l'urgence de réformer l'union de fait, mais bien de repenser l'ensemble du droit relatif aux unions d'interdépendance.
http://www.cyberpresse.ca/opinions/2010 ... cueil_POS4" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce débat est fascinant et je ne parle pas que de celui des membres ici, mais partout on ne parle que de ça. Enfin presque !


Un peu plus et je pourrais dire que les féministes tentent aujourd'hui, de prendre en otage la liberté des femmes qui malheureusement, sont encore démunies. Peut être aussi, d'éviter un juste retour de l'ascenseur aux hommes.

C'est à croire que plusieurs ont oubliées, ce pourquoi et pour qui, elles se sont battues par le passé.
Cela dit, j'ai vraiment l'impression de revivre les années 80, mais cette fois-ci, à l'envers.

À l'envers car, aujourd'hui il semble que ce sont les femmes qui s'opposent le plus, à faire reconnaître la famille dans son statut moderne, qu'est l'union de fait. Il me semble pourtant bien facile de comprendre, que l'absence de protection au sein de l'union de fait, nous ramène carrément au modèle des femmes mariées qui n'avaient à l'époque, aucun droit et qui par surcroît se taisaient, parce que le divorce n'était pour elles qu'un ticket pour la pauvreté.
De plus, je ne vois pas de raisons valables pour que les femmes s'opposent à soutenir financièrement leurs ex-conjoints si elles peuvent. Encore plus, si un réel et honnête besoin se fait sentir. À mon avis, si c'est la moindre des choses que de se soutenir financièrement pendant une union, pourquoi il en serait autrement après une séparation.
Enfin bon, je pense que cette loi avantagera, autant les hommes que les femmes et je trouve ça bien.

Vraiment, il ne faut pas penser que tous les hommes ou femmes (selon le cas), se retrouveront du jour au lendemain, dans l'obligation de verser une pension alimentaire à leur ex-conjoint(e).
De même, qu'il ne faut surtout pas oublier que ce n'est qu'une minorité de femmes mariées, qui reçoivent une pension pour elles-mêmes et que le droit à cette pension, peut être révisé en tout temps.

Quant au patrimoine familial, la question semble résolue. Mais tout de même, je pense que si la famille d'aujourd’hui (j'entends encore une fois, l'union de fait) a autant de valeur aux yeux de tous que celle d'autrefois, alors pourquoi se pose t-on la question.
Question discrimination...
Personnellement et entre autres, où je vois de la discrimination dans ce dossier. C'est que seul le mariage reconnaît la faiblesse financière que peut engendrer, telle ou telle situation familiale (particulière) pour l'une ou l'autre, des deux parties.
Je crois que c'est vraiment là, le coeur du problème.
De part et d'autre et peu importe les raisons, je comprends qu'on ne veuille pas voir nos faiblesses, encore moins les exposer.

Mais jusqu'alors, certains hommes et certaines femmes avaient par le biais de l'union libre, tout loisir de ne pas avoir à comparer leurs faiblesses de couple, si je peux m'exprimer ainsi, à celles des couples mariés. Ce que je trouve, on ne peut plus discriminatoire. La réalité est souvent toute autre, que le jugement que nous portons.
Pis à par ça, la majorité des couples se disent engagés, l'un envers l'autre.

Alors tout est bien qui fini bien.


 Une fois qu'on a donné son opinion; il serait logique qu'on ne l'ait plus. (Albert Brie)
Une fois qu'on a donné son opinion; il serait logique qu'on ne l'ait plus. (Albert Brie)